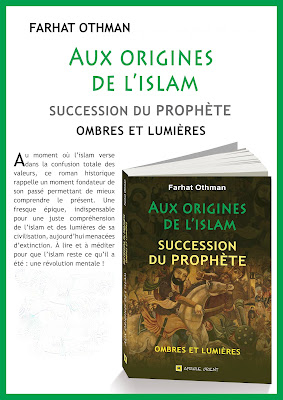Du lion et du renard (suite et fin)
Roman-feuilleton du Ramadan
Aux origines de l'islam
Succession du prophète, ombres et lumières
Fresque historique de Farhat OTHMAN
(Texte intégral)
Partie IV
Les vices et les vertus
ou
Les infortunes du pouvoir
Chapitre 3
Du lion et du renard
2/2
À Siffine, vers où avait convergé l’armée du gouverneur de Syrie, il y eut, dès l’arrivée d’Ali d’AlKoufa, des escarmouches en prélude au combat, une lutte pour la maîtrise du chemin menant à l’Euphrate, seule eau du coin. Cette voie était sous le contrôle des troupes syriennes arrivées les premières sur le site et Mouawiya refusa la demande d’Ali de laisser à ses troupes l’accès à l’eau. L’armée irakienne finit par l’obtenir de force ; mais nullement rancunier, Ali permit à ses adversaires d’accéder à la précieuse eau.
Deux jours passèrent ensuite d’un face à face muet avant qu’Ali ne tentât une délégation auprès de son rival. Contre l’avis d’un certain nombre de ses hommes souhaitant une contrepartie à sa demande afin de lui assurer quelque chance de succès, il se contenta de réclamer l’allégeance. Aussi, l’échec de l’initiative ne surprit personne et les deux armées restèrent encore à s’observer quelques jours, n’engageant que des duels entre les meilleurs de leurs chevaliers à raison d’un par jour ou même deux. Cela dura tout le mois de Dhoul-hijja, le dernier du calendrier hégirien. Chaque matin, dans l’avant-garde de son armée, Ali venait défier l’ennemi, chantant :
Je les frappe, mais je ne vois Mouawiya,
Aux yeux globuleux, au bassin gras.
Ce jour-là, comme d’habitude, il vint défier ses adversaires au combat ; cette fois-ci, pour la première fois, il s’adressa à leur chef :
— Mouawiya, pourquoi faire se tuer les gens ? Je te provoque en duel et le pouvoir sera au vainqueur !
L’interpellé écouta sans broncher la proposition ; son compagnon Amr Ibn Al’Ass, à ses côtés, se tourna vers lui et commenta, narquois :
— L’homme t’a fait justice, hein !
On connaissait la vaillance d’Ali ; on savait ne posséder aucune chance contre lui ; aussi, la réflexion d’Amr irrita-t-elle Mouawiya ; il ne répondit pas moins avec placidité :
— Il ne m’a pas rendu justice. Tu sais bien que personne ne lui résiste au duel.
Puis, se penchant sur lui, serrant sa poigne sur sa main droite, il lui chuchota à l’oreille ce qui ressemblait à un commandement :
— Ainsi, tu lorgnes ma place après moi ! Tu as voulu ma mort, Amr. Par Dieu, je ne te pardonnerai que si tu sors le combattre, toi.
Ne pouvant se défiler à cette injonction indirecte, Amr prit la précaution de se cacher le visage, comme ne l’interdisait pas la coutume guerrière, mais que réprouvait le code de la chevalerie. Son duelliste n’aurait pas l’ardeur démultipliée, c’est ce qui comptait le plus à ses yeux.
Cela ne lui évita pas de se faire trop vite désarçonner par les ruades d’Ali qui, dès lors, s’avança vers lui, l’épée menaçante. En alerte se mit aussitôt l’ingénieux cerveau d’Amr pour lui trouver un salut manifestement désespéré. Il était par terre, sans arme, et la mort venait à lui au bras d’Ali. Seul un acte spectaculaire pouvait retenir la main du très moral et très pudique Ali, lui sauver la vie.
Une fulgurance lui rappela, du temps de l’épopée du prophète, un acte d’Ali qui surprit son monde ; ayant eu à sa merci un adversaire combattu en duel, il lui tourna le dos et ne l’acheva point quand il se retrouva nez à nez avec son sexe dénudé. À son cousin étonné, il répondit qu’il eut honte. Et Amr pensa qu’il n’y avait que l’obscénité pour triompher de la pudeur.
Aussi, sans nulle honte, à presque deux cent mille yeux observant la scène, excitant même sa témérité, il n’hésita pas à s’offrir en spectacle. Le haut du dos au sol collé, y fixant bien les pieds, il releva son bas-ventre ; puis, d’un geste leste, il releva sa tunique, se dénudant, offrant à son attaquant ses parties génitales. Faute d’être salvateur, ce geste serait celui de l’ultime mépris ; et il se révéla la plus sûre parade, le meilleur des boucliers.
Pour Ali, l’histoire se répétait ; élevé dans une tradition communautaire de la pudeur excessive, il trouvait honteuses les choses du sexe et la simple vue des plus banales parties du corps humain habituellement couvertes demeurait choquante ; celle du sexe était même sacrilège et sa provocante exhibition ne pouvait que relever de l’œuvre démoniaque.
À la surprise générale, il fit se détourner son cheval, s’en allant, fuyant cet homme immoral osant exposer sa nudité. Ainsi le sexe eut-il encore raison des armes ! Et ces parties génitales exhibées allaient même changer le sort d’une bataille, le destin d’une communauté.
La scène ne manqua pas de faire couler de la salive dans les deux camps et, rapidement, l’identité de l’exhibitionniste fut connue. On évoqua l’épisode chez Ali qui se garda d’en regretter l’issue, se contentant de commenter :
— Quand rougit la guerre, que la bataille fait rage et que les épées cueillent les têtes, cet homme – que Dieu le fasse étouffer et qu’il l’affligeât – n’a pour souci que d’enlever sa culotte et d’offrir ses parties aux regards.
Et Mouawiya, chaque fois qu’il avait la scène en mémoire, à pleines dents en riait. Une fois, on le vit se mettre à pouffer sans raison ; à la question de son âme damnée sur le pourquoi de ce rire, il répondit en continuant à s’esclaffer :
— Je ris de ta présence d’esprit lors de ton duel avec Ali dont tu t’es préservé avec tes parties génitales. Par Dieu, tu as eu affaire à un généreux bienfaiteur ; il aurait pu t’embrocher avec sa lance par le pli de l’aine.
Vexé, Amr se vengea en pointant la couardise de son compère :
— Il fallait te voir quand il te provoqua en duel. J’étais à ta droite et je voyais tes yeux qui louchaient et tes poumons qui enflaient. Tu apparus dans un état tel que je n’oserais décrire.
Mouawiya se savait redevable du précieux appui d’Amr Ibn Al’Ass; il se devait de s’assurer la fidélité de ce malin hors pair. Pourtant, quand il était venu le voir en Syrie au lendemain de l’assassinat d’Othmane pour lui proposer ses services, il le snoba.
Quand il le vit désobéir à l’un de ses deux fils lui déconseillant de combattre Ali, suggérant la neutralité pour écouter plutôt l’avis du second qui estimait qu’une aussi forte personnalité ne devait pas rester en marge des événements importants secouant sa communauté, il lui dit alors :
— Amr, tu veux alors vraiment me suivre tout le temps ?
— Vers où ? fit mine de demander Ibn Al’Ass avant d’ajouter : vers l’au-delà ? Par Dieu, il n’est nulle vie future avec toi. Serait-ce alors pour ici-bas ? Par Dieu, je ne te suivrai que si je suis ton associé dans cette vie terrestre.
— Alors, tu es mon associé ici-bas, dit posément Ibn Abi Soufiane.
— Mets donc l’Égypte et ses contrées à mon nom, prescrivit Amr, sûr du poids de sa science au service des visées de son ami.
Peu de jours auparavant, il lui avait fait parvenir une missive rimée :
Mouawiya, je ne te donne pas ma foi tant que je n’ai
De toi, contre elle, ce monde ; vois donc comment procéder ;
L’au-delà et ici-bas ne sont pas équivalents ; mais
Je prends ce que tu donnerais les yeux fermés.
Si tu me donnais l’Égypte, me faisant gagner un marché,
Un chef sachant nuire et être utile tu te serais assuré.
Lui abandonnant en butin ce qu’il avait demandé, Moyawiya prit la précaution d’ajouter, en bas de l’écrit, la mention suivante : « Avec l’engagement d’Amr à l’obéissance et au service ».
Cette précision déplut à l’intéressé, lui paraissant comme une restriction et il tint à y accoler un complément manuscrit. Mouawiya discuta un moment de l’intérêt de cet ajout dans la mesure où le document était appelé à demeurer secret ; mais l’insistance de son acolyte l’y contraignit. Aussi, ajouta-t-il : « L’obéissance et le service ne retranchant rien à ce qui est stipulé ».
S’étant assuré la riche province d’Égypte sur laquelle il a toujours eu des visées et ce depuis le jour où, à la tête des armées musulmanes, il était censé y venir pour répandre des principes religieux bien loin d’intérêts bassement matériels, Amr mit son ingéniosité au service des ambitions de l’Omeyyade.
Il lui conseillait ses initiatives d’approche des gens, sa politique de communication, usant de tous les ressorts, psychologiques, matériels et moraux. Dans ce cadre, il reçut avec lui un dignitaire qu’il lui avait conseillé d’appâter pour profiter de ses entrées et de son ascendant sur le commun du peuple. L’homme qui avait fréquenté le prophète se fit asseoir entre eux deux et écouta en silence Mouawiya lui tresser des couronnes avant d’évoquer le souvenir d’Othmane et solliciter son ralliement à sa cause. Parlant posément, il lui répondit ensuite :
— J’ai bien entendu ce que tu as dit. Mais, savez-vous pourquoi j’ai pris place entre vous deux ?
— Oui, fit aussitôt Mouawiya ; à cause de ta dignité, ton antécédence et ton rang.
— Non, je le jure par Dieu, dit-il, en levant l’index au ciel. Je ne me suis pas assis entre vous pour cette raison. Au demeurant, je ne me serais jamais assis avec vous ; mais c’est parce que je me suis rappelé ce que le prophète avec qui je cheminais lors de l’expédition de Tabouk nous confia quand il vous vit marcher tous les deux en vous parlant. Il se tourna vers nous et dit : « Si vous les voyez réunis, séparez-les, car ils ne se réunissent jamais pour le bien !». Aussi, je vous sépare. Pour ce que vous me demandez, je note que vous avez un ennemi bien coriace ; par conséquent, je reste à l’affût en me tenant à l’écart. Si vous vous réunissez sur quelque chose, alors je vous rejoindrai.
À Siffine, le mois de Dhoul-hijja, celui du pèlerinage, de l’an 36 hégirien était passé et on était entré dans la nouvelle année ; de part et d’autre, les combattants n’excluaient pas de voir leurs dirigeants arriver à conclure la paix. L’entrée du mois de Moharram – où traditionnellement tout acte de guerre était banni – nourrissait encore plus cette pensée.
De fait, les deux parties s’engagèrent à respecter la trêve de tradition et les messagers circulèrent entre les deux camps, mais leurs échanges relevèrent plutôt du dialogue de sourds. Les envoyés d’Ali personnalisaient la problématique, usant davantage d’arguments moraux, en insistant sur les qualités tant humaines que religieuses de leur chef, sa parenté avec le prophète, son haut rang dans l’islam et la responsabilité de ses adversaires de diviser irrémédiablement la communauté et de verser le sang musulman. Ceux de Mouawiya avaient la partie belle ; ils se permettaient de situer le débat au niveau légal en ramenant toute issue de secours à la résolution d’un acte illicite, celui du meurtre du premier homme politique de l’État.
Aux interrogations des premiers, volontiers teintées de réprobation, sur la responsabilité d’oser tuer des figures des plus illustres parmi les Compagnons du prophète, les seconds répondaient cyniquement qu’ils n’hésiteraient pas à tuer leurs frères de sang pour venger une mort injuste. L’interrogation sur la mort d’Othmane et son éventuelle légitimité ne manqua évidemment pas d’être posée à Ali qui ne chercha pas à l’éluder sans cependant adopter une attitude sans ambiguïté. À la question s’il témoignerait que Othmane fut tué injustement, il répondit simplement qu’il ne dirait pas qu’il eût trouvé injustement la mort ni qu’il l’eût méritée.
Quand vint le premier jour de Safar, deuxième mois du calendrier de l’hégire, on vit s’avancer du côté syrien cinq lignes de combattants qui s’étaient attachés les uns aux autres par leurs turbans et avaient juré de vaincre ou mourir. Les Irakiens, emmenés par AlAchtar, allèrent à leur rencontre et on se battit rageusement presque toute une journée durant laquelle on n’entendit que le hennissement des chevaux, le cliquetis des armes et le brouhaha des troupes.
Aussi rudes que furent les engagements, ils n’étaient pas moins entrecoupés par des moments de répit au moment des cinq prières, chacune des parties veillant particulièrement à acquitter à l’heure son principal devoir religieux. De part et d’autre, l’ostentation dans le respect de cette prescription majeure était à l’égal du recours à la poésie, forme arabe éminente de communication, notamment en son mètre prosodique le plus populaire, le rajaz.
Et la haine des armes n’interdisait pas la malice des esprits et le flirt des intelligences. Il y avait chez Mouawiya des hommes d’Ali faits prisonniers qu’Amr conseilla de mettre à mort. L’un d’eux excipa de sa parenté pour demander la vie sauve.
— Tu es mon oncle, dit-il à Mouawiya incrédule.
Obtenant la vie sauve pour lui expliquer ce lien de parenté, il lui fit un raisonnement dont Mouawiya ne put qu’apprécier l’intelligence :
— Ta sœur n’est-elle pas une femme du prophète ? demanda l’homme ; or, je suis son fils ; et comme tu es son frère, donc, tu ne peux qu’être mon oncle !
Mouawiya n’écouta pas toujours Amr. Il ne voulait pas être en reste par rapport à son adversaire qui ne manquait aucune occasion pour faire montre de sa hauteur d’âme et de la noblesse de ses sentiments. Quand il vit un jour des hommes faits prisonniers par Ali revenir libres dans son camp, il fut heureux de pouvoir rendre la pareille à son adversaire avec des prisonniers qu’il s’était retenu d’envoyer ad patres.
C’était la nuit du mardi à mercredi, quelques jours après la fin du mois sacré, alors que les escarmouches et les duels duraient depuis une semaine. Le crépuscule venu, on avait entendu l’aboiement d’un crieur du côté des troupes irakiennes. Il s’était adressé aux ennemis :
— Oyez ! oyez ! le prince des croyants dit vous avoir accordé un délai pour revenir à la vérité et vous repentir. Il vous a rappelé le livre de Dieu, Puissant et Grand, et vous y a renvoyé ; mais vous n’avez eu de cesse de persévérer dans votre perfidie, refusant la vérité. Aussi, et sans façon, rejette-t-il tout pacte avec vous : « Dieu n’aime pas les félons ».
Entendant cette annonce, notamment sa fin s’inspirant de la sourate « Le Butin » et se terminant par un extrait de son verset 58, on comprit que c’était la guerre. Et ce fut un branle-bas de combat aussi bien dans le camp des Syriens que celui d’Ali.
Ce dernier venait de décider de lancer dans la bataille, le lendemain, toute l’armée de plus en plus impatiente d’en découdre. Il conseilla à ses hommes de passer la nuit à prier, à réciter du Coran et à implorer Dieu de leur accorder la victoire et la patience. Au creux de la nuit, on entendait un chant populaire ; un guerrier taquinait la muse :
Dans une situation étonnante, la nation s’est retrouvée ;
Et demain à qui vaincra, la souveraineté est assurée.
Sans mensonge, je tiens le propos de la vérité,
Demain, des étendards arabes, il s’en sera terminé.
Le jour de la bataille était enfin arrivé ; Ali s’adressa à ses troupes :
— La mort est un demandeur à qui n’échappe pas le fuyard et qui n’oublie nul résident ; il n’est pas d’échappatoire à la mort. Par celui qui a en sa main la vie d’Ibn Abi Taleb, je le jure : un coup de sabre est bien plus léger que la mort au lit. Parez les sabres avec vos visages et les lances avec vos poitrines. Et je vous donne rendez-vous autour de la bannière rouge.
Sur le peu de jours que dura la vraie bataille, les combats furent équilibrés au début. Chaque matin, Ali répétait ses consignes à ses troupes pour une guerre propre et morale, leur faisant crier ses interdictions. Voulant moraliser sa guerre à la manière de sa vie, il leur demandait de ne pas achever le blessé, ne pas poursuivre le fuyard, ne pas dépouiller le mort et ne pas s’en prendre à qui ne combattait pas.
Dans cette bataille fratricide, comme celle du dromadaire, nombre de guerriers avaient choisi la neutralité ne sachant à qui donner raison, à qui donner tort. Mais la mort de figures importantes de l’islam et surtout de Compagnons pour la cause d’Ali fit se rallier à lui d’appréciables groupes de neutres suivant l’exemple de ces personnalités. Parmi celles-ci, il était un vieillard très brun, de haute stature, s’appelant Ammar Ibn Yassir. Malgré ses quatre-vingt-dix ans, Mouawiya le redoutait et le fit souvent attaquer par une escouade. Nullement gêné par une main que la vieillesse faisait trembler, il bataillait vaillamment en criant :
— Par trois fois, avec cette lance, j’ai combattu auprès du prophète ; et c’est la quatrième. Par Dieu, quoi qu’ils fassent, je sais que nous sommes dans la vérité et eux dans le mensonge. Patience, ô sujets de Dieu ! le paradis est ombré de sabres.
La bataille faisait rage et Ibn Yassir savait que son heure était arrivée. Il se fit servir du lait coupé d’eau dans un grand verre à anse rouge qu’il but en disant :
— Le prophète de Dieu – que Dieu le bénisse et le salue – m’avait prédit que le lait serait la dernière chose que je boirai sur terre.
À ce moment de répit de l’aube précédant la reprise des hostilités, Ammar se laissait emporter par les souvenirs, remontant le temps, se rappelant les glorieuses heures de l’islam. Le voici avec d’autres Compagnons, lors de la construction de la mosquée du prophète à Médine, transportant les briques cuites au soleil, chantant :
Si travaillait le prophète et l’on s’asseyait,
Comme des égarés, alors, on se comporterait.
Voici Othmane, raffiné et délicat, qui tenait à rester toujours propre, ne manquant jamais de s’essuyer les mains, d’épousseter ses habits chaque fois qu’il finissait de transporter ses briques. Et voilà Ali qui, taquin et rigolard comme à son habitude, le raillait en vers :
Bâtisseur des mosquées et travailleur zélé,
Toujours incliné, toujours prosterné,
Tantôt debout, tantôt assis :
Celui-là ne peut valoir celui qu’on vit,
Constamment, la poussière éviter.
Ammar venait de reprendre la rengaine d’Ali sans savoir de qui il s’agissait quand il vit venir vers lui, Othmane menaçant, une queue de palmier à la main, apparemment vexé :
— Si tu n’arrêtes pas, je te frappe au visage !
Le prophète n’était pas loin ; assis à l’ombre d’un mur, il entendait tout ; à haute voix, mettant un doigt entre les deux yeux, il dit :
— Ammar est la peau qui est entre mon oeil et mon nez.
Othmane délaissa alors Ammar que les gens aussitôt entourèrent en le pressant de parler au prophète :
— Il s’est fâché pour toi ; on a peur qu’il n’y ait du Coran nous concernant.
Il s’engagea à le calmer et alla auprès de lui :
— Prophète de Dieu, qu’ai-je fait à tes compagnons ? lui demanda-til en affectant un air courroucé.
— Et qu’est-ce qu’ils t’ont fait ? interrogea le prophète.
— Ils veulent me tuer. Ils transportent chacun une brique et m’en font porter deux, répondit-il en souriant.
Mohamed se leva alors et le prit par la main, faisant quelques pas ensemble dans la mosquée en construction ; puis, lui enlevant de la poussière sur le visage, il dit :
— Mes compagnons ne te feront pas de mal ; mais tu seras tué par la faction rebelle.
Ce matin-là, à Siffine, Ammar se rua au combat en chantant :
Aujourd’hui, je retrouve les chéris,
Mohamed et son parti.
De tous côtés, les hommes de Mouawiya réussirent à l’entourer ; il se défendit vaillamment, mais finit par plier sous le nombre, tombant sous les coups de deux cavaliers qui le décapitèrent. Quand les deux hommes apportèrent la tête à Mouawiya, se disputant chacun sa mort, quelqu’un leur dit :
— Que celui qui la délaisse le fasse sans regret, car j’ai entendu le prophète de Dieu – que Dieu le bénisse et le salue – lui dire qu’il sera tué par la faction rebelle.
Ces paroles jetèrent un froid sur les deux hommes ; Mouawiya rectifia alors, osant une interprétation hardie :
— C’est l’autre camp qui l’a tué ; ce sont eux qui l’ont amené avec eux à la mort !
On rapporta ces propos à Ali qui s’en gaussa, citant la mort d’Hamza, l’oncle du prophète, à Ouhod par les mains des païens de Qoraïch :
— Et Hamza fut aussi tué par nous puisque nous l’avions amené à la bataille !
La bataille fit rage toute la journée du mercredi et, le soir venu, on se quitta sans qu’aucune partie n’ait réussi à avoir l’avantage. On s’était pourtant déchiqueté aux lances jusqu’à plus de manches ni de fer ; on s’était servi des arcs jusqu’à l’épuisement des flèches et on s’était battu aux sabres, corps à corps, pied à pied.
Le lendemain, les combats reprirent de plus belle. On vit les Syriens réussir à défoncer l’aile droite des troupes d’Ali qui vira vers l’aile gauche, entouré de ses enfants AlHassan, AlHoussayn et Mohamed qui le protégeaient. Il passait d’une aile à l’autre, poussant inlassablement ses bataillons vers l’avant.
Soudain, un homme s’approcha de lui pour l’attaquer ; on y reconnut l’un des esclaves d’Othmane ; Kissane, l’affranchi d’Ali alla à sa rencontre, mais trouva la mort. Arrivant à la rescousse, Ali se saisit d’un pan de la cotte de mailles de l’homme et le relevant au-dessus de sa tête le fit s’écraser sur le sol.
En face, on voyait Amr Ibn Al’Ass, la main posée sur l’épaule de son esclave, marcher dans ses pas. Il lui avait ordonné de marcher devant lui, le menaçant de lui faire tomber la tête si jamais il reculait ou essayait de fuir. Et le serviteur avançait en se retournant de temps en temps vers son maître, répétant :
— Je t’amènerai au bord de la mort.
Les rangs des hommes qui, à la manière des Perses s’enchaînant pour ne pas fuir la mort, s’étaient attachés les uns aux autres avec leurs turbans, étaient solides dans les troupes syriennes ; ils entouraient avec d’autres cavaliers la grande tente de leur chef recouverte de vêtements et de peaux de toutes les couleurs, la protégeant des assauts.
Encadré de ses gens de la tribu Rabi’a, Ali était en sécurité, mais son armée était dévastée et ses hommes issus des autres tribus étaient mis en déroute. Il appela à lui AlAchtar et lui demanda d’arrêter la débandade de ses hommes en leur criant : « Où fuyez-vous la mort qui n’est jamais réduite à l’impuissance vers la vie qui ne durera point à personne ? »
Répétant les paroles de son chef, AlAchtar ne sut convaincre qu’une minorité à revenir au combat. Il usa alors dans un répertoire qu’il connaissait ne jamais faillir. Appelant chaque tribu par son nom, il blâma la couardise, vanta la bravoure et les mœurs guerrières. Et il réussit, redressant l’aile droite et finissant, moyennant une contre-attaque rageuse à la tête d’une escouade de lecteurs, par s’enfoncer dans les rangs des Syriens et de venir menacer tout près leur chef et sa garde rapprochée entre l’heure de prière de l’après-midi et celle du coucher du soleil.
On combattit toute la nuit jusqu’au matin du vendredi ; c’était la nuit dite du « Harir » (Gémissement). Dans l’obscurité déchirée par les flammes folles des flambeaux, éclairée des éclats vagabonds du contact des armes en colère, on n’entendait que du gémissement, la voix des hommes se mêlant avec celle des arcs. Ce fut la plus importante journée de la bataille ; les morts se comptèrent par cinquantaine de mille du côté des Syriens de Mouawiya et moins de la moitié du côté des Irakiens d’Ali.
Dans la matinée du vendredi, troisième jour de la bataille, on vit Ali au cœur de ses troupes, Ibn AlAbbès sur l’aile gauche et AlAchtar sur la droite. Ses troupes fonçaient sur l’ennemi ; elles semblaient avoir la partie gagnée. La victoire paraissait à la portée de main de l’aile droite de l’armée d’Ali emmenée par AlAchtar. Décimant les quatre premiers rangs parmi les guerriers attachés par leurs turbans, ses lecteurs n’avaient plus en face d’eux qu’un rang de cavaliers pour accéder à Mouawiya.
Autour de sa tente de peaux, Mouawiya voyait les Irakiens défoncer ses lignes les unes après les autres ; ils étaient désormais tout près de la tente de commandement. Et il cria qu’on lui apportât son cheval ; assurément, c’était la défaite ! l’ennemi était sur le point de se ruer sur lui. La tête pleine de poésie antéislamique célébrant la vaillance, il hésitait cependant entre la fuite et la résistance désespérée.
Debout à côté de lui, Amr voyait surtout les bleus parages du Nil et les contrées verdoyantes d’Égypte lui échapper. Mais, il n’était pas homme à lâcher tout espoir, surtout dans le plus noir désespoir. Et d’un geste ferme, il retint Mouawiya qui avait déjà enfourché sa monture.
Ce moment, il y avait songé sans trop vouloir y croire ; aussi, les précédents jours, conseilla-t-il à Mouawiya d’ordonner à ses hommes de veiller à ne sortir à la bataille qu’avec leur Coran sur eux. Bien évidemment, il s’abstint d’expliquer sa motivation ; il lui suffisait qu’on pensât que c’était par pure dévotion, pour faire le pendant à l’armée adverse bondée d’hommes vertueux et de lecteurs spécialisés du livre de Dieu, ces hommes aux manteaux à capuchon. Son but véritable était tout autre ; le moment était arrivé pour le mettre à exécution.
— Qu’as-tu ? demanda l’Omeyyade, hésitant encore à prendre la fuite.
— J’ai à te proposer quelque chose qui ne fera que renforcer nos rangs et diviser davantage les leurs. Tu donnes l’ordre à tes hommes de lever leur Coran sur le bout des lances et de crier : Voici le livre de Dieu pour arbitrer entre nous !
Il n’était pas sûr que cette ruse marchât ; Ali n’en serait pas dupe, mais il le savait de plus en plus prisonnier des exigences de ses hommes enchérissant davantage chaque jour dans l’extrémisme moral et l’intégrisme religieux. Il suffisait que les capuchons, ses lecteurs, tombassent dans le piège pour qu’Ali, de gré ou de force, y soit précipité. Le pressentiment d’Ibn Al’Ass était d’une ingéniosité diabolique.
Se voulant des hommes de religion et des combattants de Dieu avant d’être des guerriers ou des hommes de guerre, les soldats d’Ali furent troublés à la vue de leurs adversaires baissant la garde et levant le livre saint sur leurs lances, appelant à son arbitrage. Ils leur tonitruaient :
— Voici le jugement du livre de Dieu entre nous !
Et la confusion gagna rapidement leurs rangs. L’armée victorieuse se divisa entre ceux qui voulaient continuer la bataille et ceux qui appelaient à l’arrêter. Et les Syriens les incitaient à l’arrêt des combats en jouant sur leur fibre patriotique ; certains leur criaient ainsi :
— Qui resteraient de nous pour défendre les frontières syriennes ?
— Qui resteraient de vous pour défendre les confins irakiens ?
Divisés, les hommes d’Ali se querellèrent. D’aucuns fulminaient :
— Répondons au Livre de Dieu ! Nous acceptons son jugement !
D’autres vociféraient :
— Pas d’arbitrage ! Nous sommes sûrs de notre droit et nous n’en doutons point !
La trouvaille d’Amr sauva l’armée de Mouawiya du désastre. Sur la monture de la honte, délaissant la fuite, ce dernier demeura devant la tente à observer avec gourmandise les remous dans le camp adverse. Les Irakiens se détournaient d’une victoire à portée de main pour plonger dans les travers de leurs interminables discussions. Et le plus gros des armées de Syrie, le Coran toujours ouvert au bout des lances, était de plus en plus acquis à la certitude d’avoir sauvé sa peau.
Mais celui qui devait être aux anges et savourer le succès de son stratagème était comme absent ; son malin cerveau songeait déjà à une suite à donner à ce premier succès. Mouawiya, quant à lui, avait assez de réalisme et de cynisme pour ignorer les implications de l’acte honteux qu’il s’était permis au moment où la défaite était quasi certaine ; l’important était d’avoir réussi à retourner la situation en sa faveur même si les poètes n’allaient pas manquer de railler son moment de faiblesse et sa fuite devant la mort.
Bientôt, en effet, Kaïs Ibn Amrou, surnommé le Négus (EnNajachi) à cause de l’origine éthiopienne de sa mère, le raillera en l’appelant par l’un de ses surnoms :
Et Ibn Harb a été sauvé par un cheval véloce
Hennissant fort quand approchèrent les lances !
À suivre...
Publication sur ma page Facebook et désormais ici, sur ce blog, après la renonciation de Kapitalis à publier la fin du roman. Cf. à ce sujet, ici sur ce blog: Mythe d’indépendanceet crédibilité perdue de Kapitais
COPYRIGHT :
Aux origines de l’islam
Succession du prophète,
Ombres et lumières
© Afrique Orient 2015
Auteur : Farhat OTHMAN
Titre du Livre : Aux origines de l’islam
Succession du prophète, Ombres et lumières
Dépôt Légal : 2014 MO 2542
ISBN : 978 - 9954 - 630 - 32 - 7
Afrique Orient - Maroc
159 Bis, Boulevard Yacoub El Mansour - Casablanca
Tél. : 05 22 25 98 13 / 05 22 25 95 04
Fax : 05 22 25 29 20 / 05 22 44 00 80
PAO & Flashage : 05 22 29 67 53 / 54 - Fax : 05 22 48 38 72
E-Mail : africorient@yahoo.fr
https://www.facebook.com/AfriqueOrient